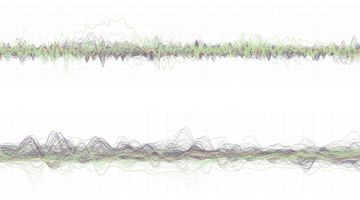Sous la bannière du solarpunk dansent certaines pratiques artistiques

La pulsion de vie rythme et anime tout autant certaines pratiques issues du champ de l’art contemporain, que les fictions d’un genre nouveau : le solarpunk.
En 2008, l’auteur anonyme du blog Republic of the bees publie le billet « From Steampunk to Solarpunk1 », illustré d’une photographie du Beluga Skysail, imposant cargo auquel est accroché un cerf-volant. La force du vent, complétant celle des moteurs, permettrait d’économiser jusqu’à 35 % de carburant, faisant de ce navire le symbole d’une transition vers des énergies propres. En l’honneur de son premier voyage est inauguré un nouveau genre littéraire : le solarpunk, que l’auteur définit comme un sous-genre de la science-fiction. Contrairement au steampunk, dont les récits, bercés par les ambitions techniques de la première révolution industrielle — début de l’exploitation massive des énergies fossiles —, s’inscrivent dans un cadre narratif où l’énergie à vapeur est omniprésente, le solarpunk se fonde sur le postulat anticipé d’une transition bel et bien achevée vers les énergies renouvelables. Le préfixe « solar », s’il dénote une affiliation aux énergies alternatives, et plus symboliquement à l’énergie solaire, témoigne aussi d’un élan vital pour le déploiement d’imaginaires lumineux. Loin d’un cyberpunk tantôt mélancolique, tantôt nihiliste, qui, lui, enlise tout espoir d’un avenir meilleur dans de sombres sables mouvants technoscientifiques. Le suffixe « punk » témoigne d’un attachement contre culturel, d’une liberté révoltée, subversive, aux antipodes du discours hégémonique néolibéral ou des espaces institutionnels aux cadres étriqués.
À la question de l’énergie, centrale pour appréhender le devenir de notre civilisation, sont associées des revendications d’ordre social et politique. Énergies renouvelables, écologies inclusives, technologies démocratiques et durables sont autant de composantes indissociables les unes des autres. L’approche DIY (« do it yourself » : faire soi-même) ou DIT (« do it together » : faire ensemble), à rebours de l’ultra consommation, s’impose en mode de vie. Ouvrant la voie à une plus grande forme d’autonomie, elle permet en outre de prendre conscience des ressources employées et du temps nécessaire à la fabrication d’un objet, modifiant par là-même le rapport entretenu avec ce dernier. Les « low tech » — littéralement basses technologies — qui désignent « une catégorie de techniques durables, simples, appropriables et résilientes2 » sont également de mise. Elles tranchent avec le caractère boulimique des « high tech », qui ingurgitent toujours plus de ressources, et dont la composition complexe et disparate rend le recyclage ardu. La volonté de partager les savoir-faire gratuitement et d’y contribuer collectivement fait également partie de cette philosophie. Les adeptes du logiciel libre par exemple, ou les mouvements plus hacktivistes à l’instar d’Anonymous, ont toute leur place dans les fictions solarpunk. À la différence du cyberpunk où ces stratégies sont prônées plutôt sur le mode de la résistance, elles sont ici d’ores et déjà adoptées par le plus grand nombre, comme une douce évidence.
En somme, les fictions solarpunk font rêver, elles racontent des mondes post-capitalocènes3 où l’être humain vivrait en respectant soigneusement les écosystèmes dont il est tributaire ; des mondes collaboratifs, queers, métissés, multi-spécistes. Relents coloniaux, misogynes, transphobes en sont expurgés, tandis que la relation aux vivants se cultive non plus sur la base de l’exploitation, de la destruction et du gâchis, mais bien dans une optique de préservation. Les fictions solarpunk font rêver, certes, mais n’en demeurent pas moins accessibles, crédibles, et c’est bien là une caractéristique fondamentale. Les récits déployés doivent infuser le présent pour configurer le futur : « Obviously, a major difference between solarpunk and steampunk is that solarpunk ideas, and solarpunk technologies, need not remain imaginary, and I indulge a hope of someday living in a solarpunk world4.
» écrit l’auteur du blog à l’origine du terme. Prophéties auto-réalisatrices, certaines représentations du futur participent à l’émergence d’un imaginaire social qui pénètre l’actualité. Les innovations développées par les entreprises de la Silicon Valley par exemple, sont peuplées de références à l’imaginaire transhumaniste5 issues des œuvres de science-fiction à l’instar d’Iron Man (2008) de Jon Favreau, Blade Runner (1982) de Ridley Scott, 2001 L’Odyssée de l’Espace (1968) de Stanley Kubrick, ou encore Her (2013) de Spike Jonze, pour n’en citer que quelques-unes. Les travaux de Paul Ricœur ont montré comment l’imagination, qui permet d’expérimenter mentalement des idées nouvelles, des valeurs ou encore des manières d’habiter le monde, s’appuie toujours sur des images référentielles, des images déjà vues et entendues6. Une fois l’expérience de pensée enclenchée, elle peut agir dans le champ de l’action humaine, entrer dans la pratique pour se confronter au réel. L’auteur anonyme du blog raconte justement qu’il fut particulièrement inspiré par l’ouvrage de science-fiction Songs from the Stars (1980) de Norman Spinrad, non pas pour les qualités littéraires du roman, mais bien pour l’impression indélébile de l’image d’une société reposant exclusivement sur quatre types d’énergies : le muscle, le soleil, le vent et l’eau.
Le terme tombera dans l’oubli avant de resurgir deux ans plus tard sur le forum Absolute Write. C’est finalement en 2012 au Brésil qu’est publié Solarpunk : Histórias Ecológicas e Fantásticas em um Mundo Sustenavel7 (Solarpunk : histoires écologiques et fantastiques dans un monde durable), le premier recueil de nouvelles revendiquant l’appellation solarpunk. Qu’il soit en langue portugaise témoigne d’un décentrement du genre vis-à-vis de l’ethnocentrisme blanc traditionnel. Mais il faudra tout de même attendre 2014 pour que l’expression prenne véritablement son essor. Cette année-là, dans un post Tumblr, devenu emblématique depuis, Miss Olivia Louise dépeint l’esthétique suivante : « A lot of people seem to share a vision of futuristic tech and architecture that looks a lot like an iPod – smooth and geometrical and white. Which imo [in my opinion] is a little boring and sterile, which is why I picked out an Art Nouveau aesthetic for this8.
» L’essayiste américain Adam Flynn publie un billet, lui aussi largement partagé, « Solarpunk: Notes toward a manifesto9 », où il décrit la nécessité de repenser nos infrastructures et de s’inspirer des mouvements dissidents comme celui porté par Gandhi. En 2015, le blogueur Andrew Dana Hudson écrit « I see solarpunk emerging as a reaction to this sensation of strangling decay. People want to feel the vibrancy of progress, not just the anxious giddiness of capitalist churn10.
». Bientôt, un concours de design spéculatif pensé sur le mode du solarpunk est lancé. Puis un manifeste11 circulera en octobre 2019, sans que l’on sache vraiment qui en est à l’origine.
Issu des confins d’Internet, des communautés anonymes de Reddit aux créateurs de Tumblr, le solarpunk s’affirme depuis comme un mouvement porteur d’espoir. Sans doute parce qu’elle condense tout l’enjeu dramatique du XXIe siècle, cette phrase de Flynn sera reprise à la manière d’un slogan politique, circulant sur les pages des forums : « We’re solarpunks because the only other options are denial or despair12.
» De fait, il existe un consensus scientifique sur l’enjeu vital de réduire nos émissions de gaz à effets de serre, d’atténuer drastiquement la pression exercée sur les habitats des espèces menacées et de cesser la surexploitation des ressources naturelles. Autant de contraintes qui ne pourront être respectées sans une transformation profonde de nos modes de vie et des pratiques qui en découlent13. Le paradigme du capitalisme en vigueur, basé sur l’accumulation du capital et une consommation de masse continuellement stimulée, doit être dépassé pour laisser place à des pratiques alternatives. Cela passe, d’une part, par des politiques publiques, mais également — et nécessairement —, par un changement radical de perspective, de sensibilité, de rapport au monde, et plus particulièrement au vivant, de la part des citoyen·nes. Or, force est de constater la quasi-absence de représentations mentales d’autres systèmes économiques et sociaux. Certainement répétée à outrance, la célèbre formule de Frederic Jameson (également attribuée à Slavoj Žižek) n’en demeure pas moins particulièrement symptomatique de l’ambiance actuelle : « It seems to be easier for us today to imagine the thoroughgoing deterioration of the earth and of nature than the breakdown of late capitalism; [avant de rajouter] perhaps that is due to some weakness in our imaginations14.
» Plongé dans le « réalisme capitalisme » décrit par Mark Fisher, nous errons dans un brouillard épais sans parvenir à concevoir que d’autres régimes pourraient exister, là quelque part. L’« idée [est] généralement répandue que le capitalisme est non seulement le seul système politique et économique viable, mais aussi qu’il est même impossible d’imaginer une alternative cohérente à celui-ci15. » « Il est […] une atmosphère généralisée, qui conditionne non seulement la production culturelle, mais aussi la réglementation du travail et de l’enseignement, et qui agit comme une sorte de frontière invisible contraignant la pensée et l’action16. » Les récits de science-fiction cyberpunk, s’ils passent à la loupe les tares d’un capitalisme déprédateur pour en révéler les mécanismes aliénants, ont englouti l’imaginaire collectif. Pour Fisher, la critique du capitalisme — l’anticapitalisme — aurait une place convenue au sein du régime, et l’alimenterait. Tout semble se passer comme s’il était nécessaire de mettre en scène la contestation, mais qu’au fond, personne ne croyait véritablement à une alternative crédible17. En décrivant gaiement d’autres modes de fonctionnement, plutôt que de s’épuiser à la critique, les fictions solarpunk ne pourraient-elles pas servir de guide, à la manière d’un phare brillant par temps brumeux ? La chercheuse Ariel Kroon identifie le solarpunk comme un mouvement volontairement affirmatif, incarnant l’appel de la philosophe féministe Rosi Braidotti à mobiliser la théorie et la critique au-delà de la négativité ; il ne suffit pas d’être contre, il faudrait manifester une proposition, transformer la douleur en praxis18.
Si le solarpunk se hisse en rempart face à l’urgence écologique, relève-t-il pour autant de l’utopie ? Dans un article intitulé « Is Ornamenting Solar Panels a Crime19? » (2018), la critique Elvia Wilk écrit : « Didn’t Hannah Arendt say that aesthetic production in service of idealism is what constitutes totalitarianism?
» L’histoire recèle d’exemples où un art officiel, au service du pouvoir en place, écrase toutes formes de créations divergentes. Wilk appelle le solarpunk à conserver sa dimension plurielle, libre et appropriable. Elle préfère parler de narrations disloquées plutôt que d’utopies, puisqu’il s’agit d’ouvrir les potentialités plutôt que de proposer une idée trop précise de ce qu’est le bien. « C’est toujours au nom du bien qu’est fait le mal20 » rappelle avec prudence le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein. Il n’existe pas un récit solarpunk, mais bien une infinité de possibilités, une multiplicité de manières de produire, de consommer, d’interagir entre humains et entre espèces… En somme, d’habiter notre planète.
Que peuvent les œuvres d’artistes, celles qui n’opèrent pas directement dans la sphère de la littérature ? Étendu au champ de l’art contemporain, le solarpunk pourrait se révéler être un concept fécond pour lire un ensemble de pratiques artistiques d’ores et déjà existantes21. Qu’ont en commun l’Américaine Grace Gloria Denis, le Français François Dufeil, le collectif espagnol Inland Campo Adentro ou encore le collectif SEADS, pour n’en citer que quelques un·es ? Toutes et tous sont doté·es d’une conscience écologique aiguë et cherchent à inventer d’autres manières de vivre sur Terre. Leur travail permet d’une part, une réflexion critique vis-à-vis de nos modes de vie capitalistes et de l’usage actuel des technologies ; mais permet peut-être surtout de se représenter, voire de se confronter à d’heureuses alternatives. Conscient·es d’un système qui succombe, ces artistes examinent et fabriquent des systèmes durables et solidaires ; iels conçoivent des œuvres qui s’appréhendent comme des terrains d’expérimentations sociales, techniques, économiques et profondément poétiques. Leurs processus de fabrication et de distribution apparaissent tout aussi importants que le résultat final de l’œuvre. Le philosophe Günther Anders décrit22 la façon dont la méthode de division du travail adoptée dans la production industrielle occulte ses répercussions environnementales et sociales. N’ayant accès qu’à un infime segment de la chaîne, notre sentiment de responsabilité s’en trouve dilué. De cette impossibilité à se représenter l’impact du caractère machinique de notre monde actuel et à prendre la responsabilité de nos actes, résulterait une forme d’inaction au moment même où il faudrait agir. Ainsi, penser l’ensemble de la chaîne de production, c’est permettre sa représentation mentale pour assumer ses impacts. Lucides sur le rôle de l’art quant à sa possibilité de renverser nos représentations du monde, ces artistes prônent — dans la mesure du possible — une forme de cohérence dans leur approche. Iels ne se contentent pas de rendre visible ce qui est occulté, iels prennent soin de réguler les effets de leur production sur l’ensemble du vivant. Ce sont des actions artistiques qui se conjuguent au présent, mais un « présent épais23 », celui de Donna Haraway, qui s’oppose au temps linéaire et chronologique, selon lequel une époque en remplacerait une autre. Il est constitué de mille épaisseurs, de mille couches palpables qui s’enchevêtrent. Dans un même temps, ces pratiques artistiques empruntent au passé pour distendre le présent et courber notre avenir. Souvent loin du white cube, elles sont, pour la plupart, contextuelles, collaboratives, relationnelles et décloisonnent les disciplines sans aucun complexe.

François Dufeil, Station solaire à vapeur, réalisée lors d’une résidence au Solarium Tournant. Vue de l’exposition de la Biennale de l’Architecture Disparue à Aix-les-Bains, 2020. © DR.
François Dufeil par exemple, s’est formé en génie climatique avant d’intégrer les Beaux-Arts. Il détourne des objets fonctionnels qui se rattachent aux éléments naturels comme le feu, la terre, l’air et l’eau. Extincteurs et bonbonnes de gaz, robinetteries, bouteilles de plongée et cuves glanés au fil du temps, sont agencés pour former des sculptures pouvant être activées comme des outils ou instruments, qu’il met à disposition d’autres artistes. Les pièces — un moulin à feu, une station solaire à vapeur, des instruments de musique ou encore un malaxeur d’argiles — s’inscrivent dans une démarche low tech : matériaux de récupération, faible impact environnemental, utilité sociale. Pour s’affranchir des rapports d’aliénation systémiques produits par le capitalisme, l’artiste érige l’autonomie en mode de vie, en reprenant le contrôle sur les moyens de production qu’il fabrique lui-même. Réfutant les hiérarchies imposées par une société verticale, François Dufeil déjoue volontairement les catégories usuelles entre l’art et l’artisanat, les savoirs ouvriers et ceux considérés comme intellectuels. Souvent présentées dans l’espace public, les sculptures irradient joyeusement. Leurs formes géométriques se déploient en symétrie et les couleurs franches brillent d’une intensité aujourd’hui devenue rare. Les traces d’usure des matériaux récupérés sont subtilement conservées, tandis que les lignes demeurent épurées, quasi minimalistes.

Grace Denis, Mobile Soils, Overground with SAE Greenhouse Lab, foodculture days, TETI Group, arvae, Manon Briod et Mathieu Pochon, 2022. © Ericka Calderon.
Après son passage en écoles d’art, l’artiste Grace Gloria Denis se forme à l’agroécologie, l’agriculture bio-intensive et aux stratégies de transition pour adopter des systèmes alimentaires durables. Sa pratique implique de collaborer avec des agriculteur·rices locaux·les, et ce, sur une période suffisamment longue pour tisser des liens de confiance. En échange de plusieurs semaines de travail passées dans des fermes urbaines ou rurales, elle conduit une enquête auprès des paysan·nes pour retracer l’histoire de leur agriculture locale. Elle identifie les menaces avérées ou potentielles – toxicité notable dans les sols, disparition de certaines espèces endémiques, gaspillage massif… – et mène une réflexion sur les diverses solutions envisageables qu’elle expérimentera, lorsque cela est encore possible. Abordant le repas comme un rite convivial, un moment à la fois inaugural et structurant durant lequel se transmettent des savoirs, durant lequel s’éprouvent des sensations gustatives, auditives, tactiles, visuelles, l’artiste l’investit comme lieu d’exposition et de performance collective. Les formes alimentaires pétillent généreusement, les compositions dansent au fil des mains qui se servent et les teintes se déclinent en fonction de l’âge des denrées. En fond sonore, Grace Gloria Denis diffuse un enregistrement audio qu’elle aura réalisé au préalable, lequel retrace chacune des étapes de la culture des aliments ingérés, notamment les processus de culture traditionnelle des Chinampas de Xochimilco, au Mexique, unique en son genre. Les publics attablés prennent conscience des techniques employées et renouent avec la terre et les bêtes qui les nourrissent. Bien loin des petits plats industriels, déconnectés du monde animal et végétal, Grace Gloria Denis célèbre un autre rapport au vivant, plus conscient, tout en orientant son regard vers de possibles remèdes.

Grace Denis, Listening to Chinampas and Archivo Biocultural Vivo with Cocina Colaboratorio, 2022. © Margaux Schwab.
Le collectif Inland Campo Adentro, implanté à Madrid et en périphérie, ainsi que dans différents villages d’Espagne, incorpore l’art à l’agriculture, en revendiquant une forme d’utilité dans leur pratique artistique. Grâce à des actions locales et contextuelles, mais aussi globales (réseau tentaculaire et participation à des événements culturels internationaux), le collectif œuvre à revitaliser les zones rurales. Avec l’aide de paysan·nes, théoricien·nes et architectes, le groupe d’artistes a monté une école de berger·ères qui accueille des migrant·es. En collaboration avec l’artiste Hito Steyerl, iels ont créé le cheesecoin, une monnaie locale basée sur leur production de fromage. Au dos du billet est inscrit : « The Cheesecoin is a narrative device to address exchange systems connected to lactic fermentation. Cheesecoin is not a cryptocurrency and does not require any wallet or blockchain, given the environmental cost, sheer superfluity and scam nature of many cryptobased economies. It circulates like stories and images do: from mouth to mouth, like a kiss, from screen to heart or oblivion24.
» C’est un poème, une économie alternative, une farce très sérieuse, qui sent bon le fromage de brebis.

Inland Campo Adentro, Fer Valenti, Transhumance, 2020. © Marta Goro, Fernando Valentí, Francisco Marquez.
SEADS (Space Ecologies Arts and Design) est un collectif d’artistes, de scientifiques, d’ingénieur·es et d’activistes, dont les membres viennent des quatre coins du monde. Sur son site web, il est écrit que le groupe s’engage activement dans la déconstruction des paradigmes dominants sur l’avenir et développe des modèles alternatifs, en combinant l’enquête critique et l’expérimentation pratique. Quand en 2010, le Merapi, volcan d’Indonésie situé sur l’île de Java, connaît une série d’éruptions, les membres du collectif sont invité·es à réagir. L’évènement est traumatisant pour les habitant·es qui ont dû fuir par centaines, laissant leurs maisons et les terres agricoles recouvertes de boue et de cendres. Directement inspiré des récits de science-fiction où le concept de terraformation25 revient de façon récurrente, l’artiste Angelo Vermeulen (co-fondateur de SEADS) a érigé un monument commémoratif intitulé Merapi Terraforming Project. La structure en bois sert de véritable laboratoire d’expérimentations : y sont cultivées des légumineuses à partir de bactéries fixatrices d’azote, lesquelles manquent habituellement pour assurer la croissance des plantes. Ce projet fut mené conjointement avec le professeur Prijambada, de l’Université Gadjah Mada de Yogyakarta, qui étudie la manière dont les bactéries Rhizobium fixatrices d’azote soutiennent les plantes. Pour les villageois·es, qui tendent à revenir sur l’île, malgré les risques de nouvelles éruptions, l’œuvre est un symbole d’espoir et de renaissance, entrelaçant l’art, l’astrobiologie et l’action sociale.

Angelo Vermeulen (SEADS) & HONF, Merapi Terraforming Project, 2011. © Angelo Vermeulen.
Autant de rêves lucides plantés dans le réel qui œuvrent à libérer le monde d’une condamnation fatale. Dans un contexte alors dominé par des représentations dystopiques du futur, propice au pessimisme ambiant, ces pratiques artistiques revêtent les couleurs du solarpunk. Elles se frayent un sentier sinueux vers le temps Chthulucène26 et racontent d’autres possibles en train de se faire. Les considérations d’antan, fétichisme et autre aura, sont délaissées au profit d’une pensée en réseau qui considère le processus et ses agent·es plutôt que l’objet figé. Fort·es de l’héritage légué par des artistes tel·les que Mierle Laderman Ukeles, Joseph Beuys, l’architecte Yona Friedman ou encore le designer Viktor Papanek, pour ne citer que quelqu’un·es des pionnier·ères des années 60, ces praticien·nes revendiquent un art de l’action politique, écologique et sociale, qui s’empare autant de l’économie, de la technique que de la science, mais toujours en faveur de nouveaux modes relationnels — et c’est plein de gaieté.
- « From Steampunk to Solarpunk ». Republic of the bees. 27 mai 2008. Disponible en ligne sur : https://republicofthebees.wordpress.com/2008/05/27/from-steampunk-to-solarpunk/.↩
- « Low-tech ». Wikipedia. Disponible en ligne sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Low-tech. Pour en savoir plus sur les low tech, voir l’ouvrage de Philippe Bihouix (2014). L’Âge des low tech : Vers une civilisation techniquement soutenable.↩
- Contrairement au terme anthropocène, le terme capitalocène, suggéré en 2009 par Andreas Malm, invite à penser la détérioration des écosystèmes terrestres, propre à l’ère géologique actuelle, en relation avec les modes de productions capitalistes.↩
- « From Steampunk to Solarpunk ». Republic of the bees. 27 mai 2008. Disponible en ligne sur : https://republicofthebees.wordpress.com/2008/05/27/from-steampunk-to-solarpunk/.↩
- À ce propos, voir Ariel Kyrou, « Les imaginaires transhumanistes de la Silicon Valley », dans Raison Présente, 2018/1 (N° 205), p. 49-61.↩
- Paul Ricœur, L’imagination dans le discours et dans l’action In : Savoir, faire, espérer : Les limites de la raison [en ligne]. Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 1976. p. 207-228.↩
- Gerson Lodi-Ribeiro, ed. (2012). Solarpunk: Histórias Ecológicas e Fantásticas em um Mundo Sustenavel. Editora Draco. Cet ouvrage inclut aussi plusieurs nouvelles dépeignant le cauchemar d’un « capitalisme vert ».↩
- https://missolivialouise.tumblr.com/post/94374063675/heres-a-thing-ive-had-around-in-my-head-for-a↩
- Adam Flynn (2014). « Solarpunk: Notes toward a manifesto » dans Hieroglyph. Disponible en ligne sur : https://hieroglyph.asu.edu/2014/09/solarpunk-notes-toward-a-manifesto/.↩
- https://medium.com/solarpunks/on-the-political-dimensions-of-solarpunk-c5a7b4bf8df4↩
- On peut le trouver en français sur ce site : http://www.re-des.org/un-manifest-solarpunk-francais/.↩
- Adam Flynn (2014). « Solarpunk: Notes toward a manifesto » dans Hieroglyph. Disponible en ligne sur : https://hieroglyph.asu.edu/2014/09/solarpunk-notes-toward-a-manifesto/.↩
- À ce propos, voir le dernier rapport du GIEC, qui fait référence en la matière.↩
- Frederic Jameson, Archéologies du futur, p. 366.↩
- Mark Fisher (2009). Réalisme Capitalisme. p. 8.↩
- Ibid. p. 23.↩
- Ibid. p. 19-20.↩
- Ariel Kroon. "Imagining Action in/Against the Anthropocene: Narrative Impasse and the Necessity of Alternatives to Effect Resistance." TheGoose, vol. 18 , no. 1 , article 2, 2019, https://scholars.wlu.ca/thegoose/vol18/iss1/2.↩
- Elvia Wilk, « Is Ornamenting Solar Panels a Crime? » dans e-flux, 2018. Disponible sur : https://www.e-flux.com/architecture/positions/191258/is-ornamenting-solar-panels-a-crime/.↩
- Phrase répétée par Etienne Klein dans de nombreuses conférences. Voir par exemple « Notre discours sur l’innovation rend-il justice ou non à l’idée de progrès ? » (2019), disponible en ligne sur YouTube.↩
- L’exposition « Les portes du possible » présentée au Centre Pompidou Metz consacrait d’ailleurs un espace aux représentations↩
- Günther Anders (1988). Nous fils d’Eichmann.↩
- Donna Haraway empreinte le concept à l’anthropologue Deborah Bird Rose, et le développe en 2016 dans Staying with the Trouble : Making Kin in the Chthulucene.↩
- « Cheesecoin », INLAND, Disponible en ligne sur : https://inland.org/cheesecoin/.↩
- Transformation qu’il faudrait apporter à une planète pour la rendre semblable à la Terre du point de vue de l’habitabilité par l’être humain.↩
- Concept développé par Donna Haraway dans Vivre avec le trouble. op. cit.↩